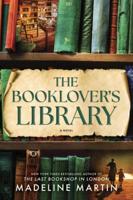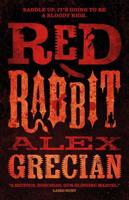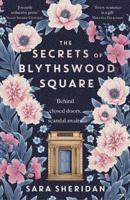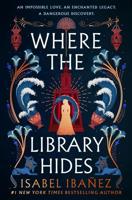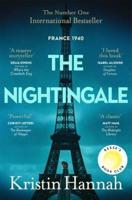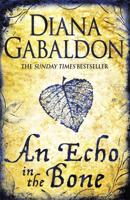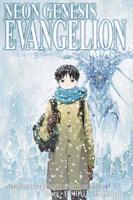Publisher's Synopsis
Les Contemplations, que Hugo fait paraître en 1856, sont à un double titre marquées par la distance et la séparation: parce que le proscrit qui, dans Châtiments, vient de fustiger Napoléon III, est en exil à Guernesey; mais aussi parce que le recueil, en son centre, porte la brisure du deuil, et ses deux parties - « Autrefois », « Aujourd'hui » - sont séparées par la césure tragique de l'année 1843 où Léopoldine, la fille de Hugo, disparut noyée. La parole poétique prend naissance dans la mort, et « ce livre », nous dit l'écrivain, « doit être lu comme on lirait le livre d'un mort ». Mais Les Contemplations construisent aussi une destinée. Il se peut qu'elle emprunte à la biographie de l'écrivain; on se tromperait pourtant à la confondre avec la sienne. Car si le lyrisme de Hugo touche à l'universel, c'est que le poète précisément dépouille ici l'écorce individuelle pour atteindre à l'intime: le sien propre et celui du lecteur qui saura ainsi se retrouver dans le miroir que lui tendent ces Mémoires d'une âme. Hugo écrit Les Contemplations en 1856 alors qu'il vit un exil politique (thème qu'il abordera dans Les Châtiments). Il vit aussi depuis plusieurs années un exil intérieur qui hante Les Contemplations. Composées de deux parties distinctes, « Autrefois » et « Aujourd'hui », Les Contemplations est la première oeuvre poétique maîtresse d'Hugo, plus de dix mille signes jetés à la face de la mer et du ciel sur l'île de Jersey.
Marqué à tout jamais par la mort de sa fille Léopoldine, Hugo annonce dans sa préface qu'on ne peut réconcilier ces deux parties: « un abîme les sépare, le tombeau. » Les plus beaux poèmes d'Hugo sur la force de la nature, la nostalgie de l'enfance et la fatalité de la mort se trouvent dans Les Contemplations. Ils sont indépassables. Dans cette oeuvre en vers, Hugo joue d'une variété de rythme et de ton assez incroyable.
Classique par moment, romantique, sage parfois, vénérant ses maîtres Gautier, Le Conte de L'Isle ou Banville, romantique déchaîné souvent comme dans « Réponse à un acte d'accusation » - poème que l'on peut considérer comme la profession de foi romantique d'Hugo - partout et tout le temps, Hugo réinvente l'acte de création poétique.
Ce que dit « La bouche d'ombre », poème de huit cents vers, nous fait atteindre un degré supérieur dans l'ordre de la vision poétique. Le verbe d'Hugo se transforme en traité cosmogo-théologico-moral. « Dieu dictait, j'écrivais » constate logiquement Hugo à la fin du recueil. Aujourd'hui encore, après que Rimbaud, en lisant Les Contemplations, l'a considéré comme « le premier des voyants », que les surréalistes l'ont intronisé maître, Hugo continue d'impressionner...